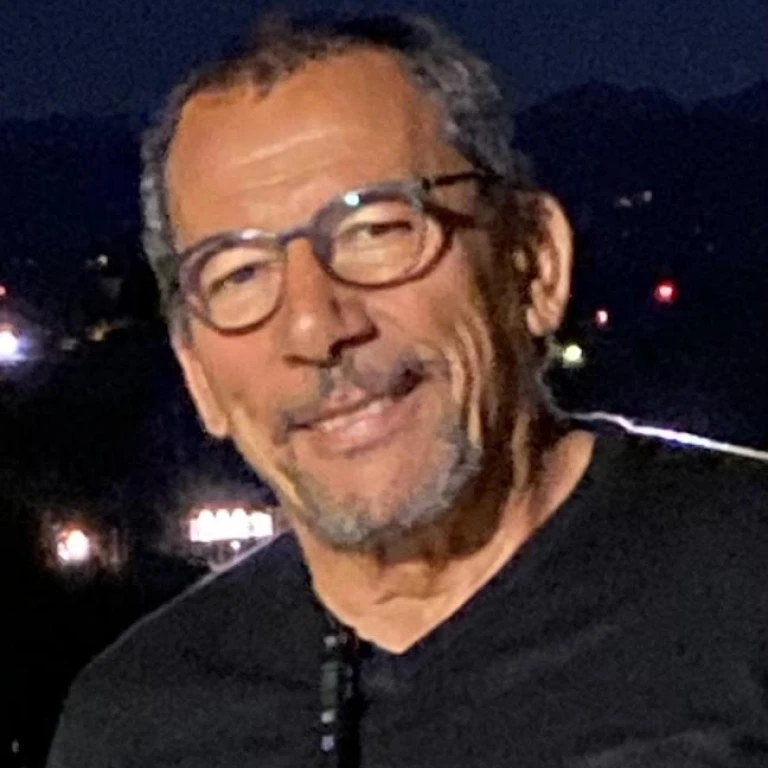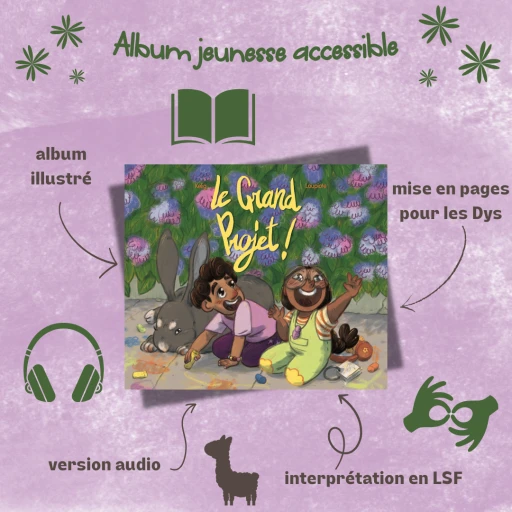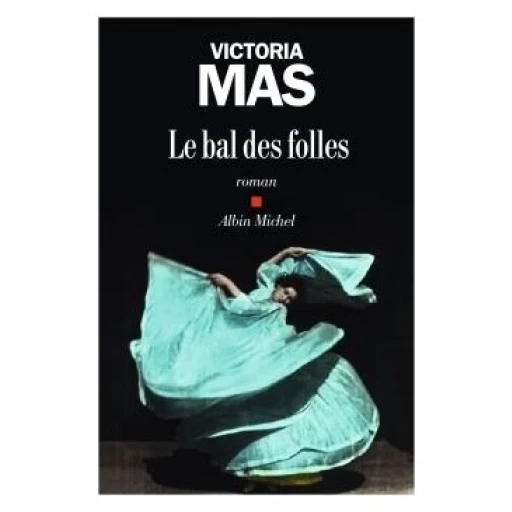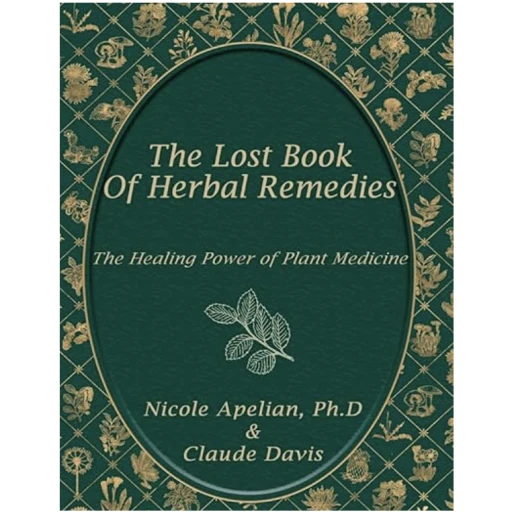Louis-Philippe, pouvez-vous nous parler de votre parcours de criminel à conférencier en criminologie? Quels ont été les moments clés qui ont jalonné cette transformation?
Mon parcours est celui d’un homme qui s’est construit à rebours. J’ai connu une enfance heurtée, une adolescence fracassée, et une entrée dans la vie par les marges. Très jeune, j’ai appris à survivre plutôt qu’à vivre. J’ai été faussaire, braqueur, évadé à huit reprises, dont deux fois des redoutés QHS. Pendant plus de vingt ans, j’ai côtoyé la violence, la cavale, la solitude, mais aussi l’intelligence de l’ombre.
Et puis un jour, j’ai compris que le plus grand exploit n’était pas de s’évader d’une prison… mais de s’évader d’un destin tout tracé. C’est là qu’a commencé ma neuvième évasion : celle qui m’a conduit à me reconstruire, à étudier en détention jusqu’à devenir l’un des détenus les plus diplômés de France, à créer des programmes de réinsertion pour d’autres détenus, puis à intégrer la société par la grande porte.
Aujourd’hui, je suis chef d’entreprise, auteur d’une saga en huit tomes, et j’interviens devant les forces de l’ordre — comme récemment à l’École de Gendarmerie de Montluçon — pour partager ce que j’ai appris de l’autre côté du miroir. Non pas pour justifier, mais pour éclairer. Parce que comprendre les criminels, c’est mieux les prévenir.
Dans le contexte de votre expérience personnelle, comment interprétez-vous 'La Neuvième Évasion – L’Odyssée d’un Hors-la-Loi'? Quel message espérez-vous véhiculer à travers cette histoire?
La Neuvième Évasion – L’Odyssée d’un Hors-la-Loi n’est pas une glorification du crime, c’est un acte de transmission. C’est l’histoire vraie d’un homme qui, après s’être échappé de toutes les prisons physiques, a compris que la seule évasion qui compte vraiment… c’est celle qui vous libère de ce que vous auriez pu devenir.
À travers cette saga, je veux montrer que la délinquance n’est pas une fatalité. On ne naît pas voyou. On le devient souvent par manque, par accident, ou par ignorance de ce que j’appelle le métier de vivre en société. Car oui, vivre ensemble, ça s’apprend — d’abord dans la famille, puis à l’école, puis dans le monde du travail.
Et contrairement à ce qu’on entend souvent, la réinsertion n’existe pas si l’on n’a jamais été inséré. Pour sortir de la délinquance, il ne suffit pas de tourner la page, il faut apprendre un métier qu’on n’a jamais exercé : celui de citoyen. Le message que je veux faire passer, c’est que cet apprentissage reste possible, même après les pires épreuves.
Mon histoire n’appelle pas à l’admiration, mais à la réflexion. À la conviction qu’on peut, un jour, choisir d’être enfin libre — en respectant les règles du jeu.
Quelle est votre analyse des causes sous-jacentes à la recrudescence des cambriolages et à la violence spectaculaire dans les faits divers en France aujourd'hui?
La recrudescence des cambriolages et des violences spectaculaires n’est pas un hasard. C’est le reflet d’un malaise plus profond : la perte de repères, l’effacement progressif des limites et la montée d’une forme de déconnexion sociale, où l’individu ne sait plus où il appartient ni à quoi il sert.
Mais attention : il ne faut pas sombrer dans le catastrophisme ni dans le wokisme. L’immense majorité de notre jeunesse est belle, lucide, pleine de force et de promesses. Elle incarne un espoir immense pour ce pays. Notre problème vient d’une minorité, pas toujours jeune d’ailleurs, qui tend à gangréner le reste par la violence, la surenchère et la défiance envers toute forme d’autorité.
Autrefois, même dans le grand banditisme, il y avait des codes. Aujourd’hui, on a affaire à une délinquance plus jeune, plus impulsive, plus numérique, qui ne cherche plus l’argent ou la fuite, mais l’effet, l’exposition, la domination immédiate. C’est une criminalité sans culture criminelle. Et c’est là qu’elle devient imprévisible, dangereuse.
Face à cela, la réponse ne peut pas être uniquement répressive. Il faut comprendre avant de punir. Éduquer avant d'exclure. Et surtout, donner aux forces de l’ordre les outils pour lire ces nouvelles mécaniques. Le terrain change : les gendarmes doivent changer avec lui, sans perdre leurs valeurs.
Vous parlez souvent de résilience et de quête de sens. Comment ces concepts se sont-ils intégrés dans votre propre processus de réinsertion et de réhabilitation après vos évasions?
La résilience n’a jamais été, pour moi, un mot à la mode. C’était une nécessité. Un réflexe de survie. J’ai encaissé les coups, les trahisons, les enfermements, les humiliations… et à chaque fois, j’ai cherché un point d’appui pour ne pas sombrer.
Mais la vraie transformation est venue le jour où j’ai compris que résister ne suffisait plus. Il fallait donner un sens à tout ça. Que chaque épreuve puisse devenir une leçon. Chaque chute, une pierre pour bâtir autre chose.
Ma reconstruction n’a pas été un programme. Elle a été un apprentissage, long et exigeant, du métier de vivre en société. J’ai étudié en prison, décroché mon bac, plusieurs licences, j’ai créé des écoles pour d’autres détenus, tout en continuant à chercher : Qui suis-je, si je ne suis plus ce hors-la-loi que j’ai été ?
La résilience, c’est ce qui m’a permis de me redresser. Mais la quête de sens, c’est ce qui m’a permis de tenir debout. Et aujourd’hui, si je parle devant les forces de l’ordre, les institutions, les entreprises, c’est parce que j’ai compris que mon parcours ne devait pas rester un souvenir, mais devenir un outil.
Je ne cherche ni la rédemption, ni les excuses. Je cherche à transmettre ce que j’ai appris à la dure. Parce que si on ne transforme pas ses cicatrices en expérience, elles finissent toujours par rouvrir.
En tant qu'ancien criminel devenu conférencier, pensez-vous que votre passé vous donne un avantage unique pour sensibiliser à la banalisation de la violence et de l'agression dans notre société?
Oui, sans aucun doute. Je ne parle pas sur la violence, je parle depuis la violence. Je ne l’ai pas apprise dans les livres : je l’ai vécue, exercée, subie, observée. Je sais ce qu’elle provoque, ce qu’elle détruit, et aussi ce qu’elle cache.
La banalisation de la violence aujourd’hui, c’est le symptôme d’un monde qui ne comprend plus les mécanismes de la haine ni les signaux faibles qui la précèdent. Quand on a vécu dans l’ombre, on apprend à les repérer : dans un regard, un silence, une posture, un mot de trop.
Mon passé me donne un avantage : je sais ce qui bascule un individu dans l’irréparable, et parfois pour des raisons qui paraissent insignifiantes à ceux qui ne les ont jamais vécues.
Je ne suis pas là pour excuser, ni pour justifier. Je suis là pour alerter, pour éclairer, pour montrer ce qu’on ne voit pas depuis un bureau. Parce que si vous voulez désamorcer une bombe, mieux vaut demander à celui qui en a déjà fabriqué une, plutôt qu’à celui qui l’a seulement étudiée en théorie.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi le Projet Phönix représente une avancée significative pour la réinsertion des détenus, et comment il a été accueilli par les institutions et les forces de l'ordre?
Le Projet Phönix est né d’un constat simple : on ne libère pas un homme avec une date. La vraie sortie, ce n’est pas celle de la prison, c’est celle de la marginalité. Et pour ça, il faut préparer bien plus qu’un trousseau de vêtements et une convocation Pôle emploi.
Phönix, c’est un programme d’apprentissage court, concret, et accessible au plus grand nombre, qui permet à un détenu de préparer son entrée dans la vie professionnelle avant même sa libération. Grâce à des permissions de sortie encadrées, il peut suivre une formation, effectuer des stages, trouver un employeur, et sortir de prison non plus comme un exclu… mais comme un professionnel en devenir.
Ce programme n’a rien d’utopique. Il est pragmatique, centré sur l’action, la responsabilisation et la préparation réelle à la liberté. Il ne remplace pas la peine, il la complète intelligemment.
L’accueil du projet a été extrêmement positif. De nombreux magistrats, gendarmes, agents pénitentiaires et directeurs d’établissement y voient une alternative crédible à la récidive, car préparer un avenir, c’est désamorcer une bombe à retardement.
Phönix, c’est une passerelle entre la cellule et le monde du travail. Et si nous voulons une société plus sûre, alors il est urgent de former les futurs citoyens avant leur sortie, pas après.
Louis-Philippe, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui considère la criminalité comme sa seule issue, à la lumière de votre voyage de la prison de haute sécurité à la plus grande école de gendarmerie nationale?
À ce jeune qui croit que la criminalité est sa seule issue, je dirais ceci : ne confonds pas la colère avec le destin. Ce que tu ressens aujourd’hui — l’injustice, le manque, la rage, le besoin d’exister — je l’ai ressenti aussi. Et j’ai cru, comme toi, que le plus court chemin vers le respect passait par la transgression. J’avais tort.
La criminalité ne mène pas à la liberté. Elle te donne l’illusion du pouvoir, puis te reprend tout : ton temps, ta dignité, ta famille, ton avenir. Tu crois prendre des raccourcis, mais tu empruntes en réalité la route la plus longue vers toi-même.
Si moi, un ancien faussaire, braqueur, évadé des QHS, je peux aujourd’hui parler à la plus grande école de gendarmerie nationale, c’est bien la preuve que rien n’est jamais figé. Que l’on peut se relever. Mais pas en un jour. Pas sans efforts. Et surtout, pas sans apprendre le métier de vivre ensemble.
N’aie pas peur de te tourner vers les autres, vers celles et ceux qui peuvent te tendre la main et t’aider à sortir de l’eau. Moi aussi, j’ai rencontré de belles personnes sur mon chemin. Et la dernière en date s’appelle Michael Di Méo, général de gendarmerie. Il ne le sait peut-être pas, mais à mes yeux, il m’a décerné le plus beau des diplômes : celui qui vient valider mon long apprentissage du métier de vivre en société.
Le vrai courage n’est pas dans l’affrontement. Il est dans le choix de bâtir. De sortir du bruit pour exister en silence. D’apprendre à te faire respecter sans jamais avoir à faire peur.
Tu n’es pas condamné à devenir ton environnement. Tu peux devenir meilleur que ce qu’on t’a laissé croire. Et un jour, tu seras fier de la personne que tu es devenu.